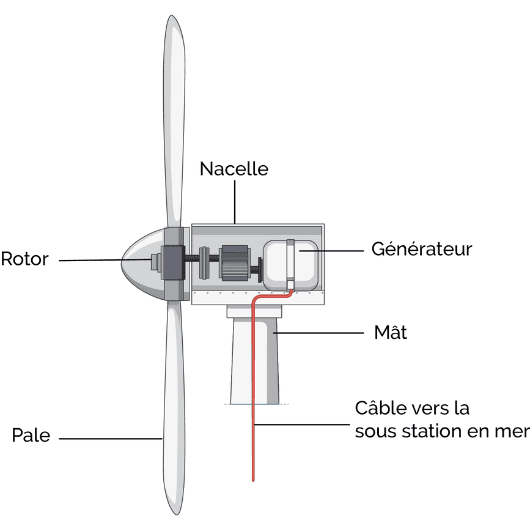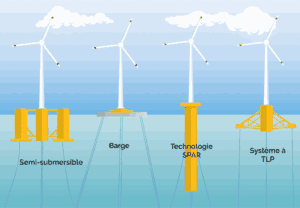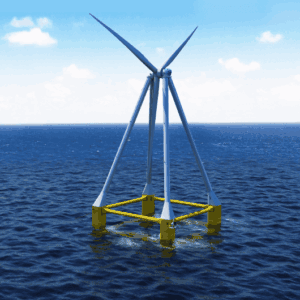L’électricité dans le monde et en France
L’électricité est devenue indispensable à notre quotidien, alimentant nos foyers, nos transports et nos industries. Dans le monde, sa production repose principalement sur des sources variées : le charbon, le gaz naturel, le fuel, l’hydroélectricité, le nucléaire, ainsi que les énergies renouvelables comme le solaire et l’éolien. Toutefois, les moyens de production diffèrent selon les pays : la plupart dépendent encore majoritairement des énergies fossiles, même si l’on assiste depuis quelques années à un investissement massif de nombreux pays dans des alternatives plus durables.
En France, l’électricité est produite majoritairement par les centrales nucléaires, qui couvrent environ 70 % de la consommation nationale. Viennent ensuite l’hydroélectricité, l’éolien et le solaire, en constante progression. Cette diversité permet à la France de maintenir une production relativement décarbonée par rapport à d’autres pays.
Face à l’essor des usages numériques, à l’électrification des transports et aux besoins liés à la transition énergétique, la demande en électricité ne cesse de croître. Pour répondre à ces besoins, tout en respectant les engagements climatiques, il est essentiel de développer davantage l’utilisation des énergies renouvelables, d’améliorer l’efficacité énergétique et d’adapter nos infrastructures.
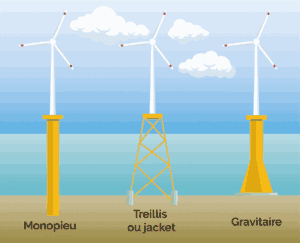




 Horaires
Horaires Contact
Contact FAQ
FAQ